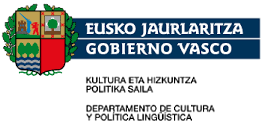Dokumentuaren akzioak
« À la fin du XIXe siècle, les maîtres danseurs sont revenus en Soule des idées plein la tête »
Entretien avec Claude Iruretagoyena/ Chorégraphe
Pouvez-vous revenir sur l’origine des maîtres à danser et leur rôle en Soule ?
Historiquement, à la fin du XIXe siècle, on pratique la danse à l’armée. Le service militaire étant alors de cinq à sept ans, on a le temps d’apprendre à danser. Chez les Basques, danser n’est pas uniquement bouger son corps. L’une des fonctions sociales de la danse étant de former physiquement et mentalement les jeunes. La danse est un art complet ; et avant d’être un langage, elle sert à la formation physique des jeunes.
Au retour de l’armée, les jeunes recrues sont détenteurs de diplômes : d’escrime et aussi de maîtres à danser. Ces derniers, à la fin des années 1800, reviennent en Soule avec des idées plein la tête. Il faut imaginer des jeunes pleins de fougue, bons danseurs et qui aiment la danse, et qui n’ont de cesse que de transmettre ce qu’ils ont appris.
De nouveaux acquis qui se sont mêlés à la danse souletine, donc.
Bien sûr, ça se mélange à l’existant. Le contraire reviendrait à dire que la danse souletine n’existe pas. On trouve trois endroits où le phénomène est bien présent : le pays de Soule, (le Labourd et la Basse-Navarre, mais ça s’est perdu), la Provence et la Sarthe. On y retrouve la même façon de danser. Chaque région s’est accaparée un fonds commun et le restitue à l’heure actuelle avec un caractère différent, bien propre.
Voilà comment s’opère le changement en Soule à cette époque. La danse s’enrichit, on aurait appelé ça du métissage, aujourd’hui, un changement de cap.
Cela va avoir une incidence sur la mascarade ?
Complètement. Autrefois, dans la mascarade, il y avait beaucoup moins de moments dansés. C’était vraiment un moment où l’on pratiquait des rituels anciens, liés aux croyances, aux superstitions, à des actes liés au carnaval, soit essayer de comprendre les mystères de la mort. Pourquoi les arbres renaissent après l’hiver et pas l’être humain ? Voilà un peu ce que pourrait être le carnaval. Une espèce de grand-messe dans laquelle on va essayer de s’attirer les bons côtés de certains dieux ou croyances pour que le renouveau s’opère ; faire que la mort n’envahisse pas l’être humain. Ça, c’est la mascarade d’autrefois, avec quelques passages dansés.
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’à la fin du XIXe siècle, comme on commence à “fabriquer de nouveaux danseurs” avec des techniques de plus en plus brillantes, on veut les montrer.
On profite donc de la mascarade pour introduire ces nouveaux danseurs, qui autrefois étaient trois. Ils n’étaient même pas forcément des danseurs, mais des personnages pouvant évoquer certains rituels. Désormais, ils sont cinq danseurs : zamaltzaina (l’homme-cheval), txerreroa (le gardien du troupeau de porcs), kantiniersa (la cantinière), gatuzaina (le “chat”) et entseinaria (le porte-enseigne).
De la même manière que de nouveaux personnages sont introduits, est-ce que certains rôles disparaissent alors ?
Oui, de nombreux éléments ont disparu. L’attrait de la danse, l’introduction de ce corps nouveau, a fait que ce qui paraissait moins important a été éliminé. Résultat, certains personnages ont disparu, certains ont changé de sens, d’autres sont devenus des danseurs et non plus des figures liées à un rituel. Par contre, les buhame, les kaute, sont restés.
Des nouveaux personnages qui nourrissent encore la mascarade actuelle ?
Ce qui nous intéresse, c’est d’essayer de retrouver d’anciennes images afin que la jeunesse comprenne les choses. Une manière de les faire avancer à leur manière et à leur envie ; c’est important. En tant que chorégraphe, je cherche à me nourrir de mélodies, de textes anciens et d’images, qui tous me donnent de nouvelles images. C’est cette tête pleine d’images qui me sert à créer de nouvelles chorégraphies. L’idée étant de donner à la jeunesse la possibilité de comprendre les différentes formes de mascarade, afin qu’ils puissent être les détenteurs de quelque chose qu’ils maîtrisent. Pour, pourquoi pas, la faire changer de sens, comme il y a 200 ans.
Vous pensez qu’une nouvelle forme de mascarade est possible ? Ou est-elle vouée à rester une tradition figée ?
Personne ne peut répondre à ça. Il y a 200 ans, personne ne s’attendait à ce que des jeunes revenus de l’armée aient envie d’introduire ces nouveautés, et par là reconditionner les choses en Soule.
Que les choses se figent obstine l’être humain depuis la nuit des temps : il faut que rien ne meure et que tout continue. Ce qui renvoie également au principal argument de tous les carnavals. L’évolution, c’est le changement ; alors bien sûr, c’est une question importante pour laquelle personne n’a de réponse. Après, je reste persuadé que les choses ne peuvent évoluer que si la jeunesse est maîtresse du sujet. Et notamment en danse, puisque la mascarade est devenue un spectacle de danse. Si cette mascarade dansée doit évoluer dans un sens nouveau, il est nécessaire avant d’y apporter un sang nouveau, de s’approprier le sujet.
Il faut avoir compris quelle était la mascarade jusqu’à aujourd’hui pour pouvoir décider ce qu’elle sera demain. Ce n’est pas possible autrement.

Dokumentuaren akzioak